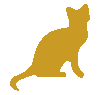23 - 05
2011

Palme d'or (remise par Jane Fonda)
"The Tree of life" de Terrence Malick
Grand prix : (remis par Emir Kusturica)
"Il était une fois en Anatolie" de Nuri Bilge Ceylan et "Le Gamin au vélo" des Dardenne
prix d'interprétation masculine : (remis par Catherine Deneuve)
Jean Dujardin pour "The Artist"
prix interprétation féminie (remis par Edgard Ramirez)
Kirsten Dunst pour "Melancholia"
prix de la mise en scène
Nicolas Winding Refn pour "Drive"
prix du scénario
"Footnote" de Joseph Cedar
Prix du jury
"Polisse" de Maïwenn
Caméra d'or
"Las Acacias" de Pablo Giorgelli (SDC)
Cinéfondation
court-métrage : palme d'or à "Cross-Cross country" de Maryna Vroda

Kirsten Dunst prix d'interprétation féminine

Maïwenn Le Besco, prix du jury

Mélanie Laurent, maîtresse de cérémonie
21 - 05
2011


Dernière soirée à Cannes vendredi, dernier doublé de films en compétition, "This must be the place" de l'italien Paolo Sorrentino ("L'Ami de la famille", "El Divo") et "Drive" du danois Nicolas Winding Refn ("Pusher", "Le Guerrier silencieux"). Du premier, on attendait tout et à la sortie, c'est un Sorrentino expatrié, décoloré, focalisé sur la performance d'acteur de Sean Penn qui surjoue dans le genre "rôle à Oscar" alors qu'on attendait de lui une interprétation intériorisée comme il en a le génie. Mais "Drive" a racheté la soirée, ovationné par le public, ce film pudique et violent sur une BO géniale a transporté le festivalier... au cinéma... L'accès à la projection de "This must be the place" n'a pas été facile, impossible de trouver des places, tout le monde en cherchait, finalement, je passe par le sous-sol du marché du film au pas de course dix minutes avant le début de la séance (pour éviter de faire le grand tour, les barrières installées jusqu'au Majestic)) et tente la file d'accès de dernière minute avec mon Pass, chose incroyable, on nous ouvre la grille, on monte les marches vers la salle Lumière mais on est dérivé ensuite sur la salle Bazin au troisième étage où, encore plus étonnant, le festival a eu la bonne idée de diffuser le film sur un second écran. Ensuite, je descends les marches vers 22h pour les remonter immédiatement pour "Drive", plus confortable car j'ai déjà ma place, ce qui ne m'arrive quasiment jamais, un ticket d'orchestre donné par Orange dans l'après-midi (merci!).
"This must be the place" de Paolo Sorrentino
Pitch.
Une ancienne rock star dépressive, enfermée avec son épouse dans un manoir irlandais, doit traverser l'Atlantique pour assister aux obsèques de son père à New York. Sur place, il poursuit la mission paternelle de traquer un ancien nazi.
On dit à Cannes que Sean Penn président du jury en 2008 aurait soufflé à Paolo Sorrentino à qui il remettait le prix du jury pour "Il Divo" qu'il était intéressé de tourner sous sa direction. Un an plus tard, un scénario sur mesure pour Sean Penn. Est-ce là le problème, cette fascination du réalisateur pour son interprète qu'il filme sans cesse en très gros plan comme un paysage qu'il ne se lasserait pas de contempler?
Deux parties dans le film, l'Irlande, où s'est réfugié l'ancienne rock star Cheyenne (directement inspiré de Robert Smith, le leader des "Cure") avec son épouse Jane, capitaine des pompiers du village. Les USA pour un road-movie, quête identitaire, encore un... Cheyenne, quinquagénaire dépressif, usé, a renoncé à chanter après le suicide de deux jeunes fans dont il va régulièrement fleurir la tombe. En cause, ses chansons sinistres qu'il écrivait ainsi pour gagner un maximum de blé, selon ses dires. Aujourd'hui, Cheyenne produit mollement Mary, leur fille adoptive et un certain Desmond. Soudain, son père qu'il n'a pas revu depuis plus de trente ans meurt, Cheyenne est obligé de partir pour New York assister aux obsèques, en transatlantique puisqu'il a peur de l'avion. Apprend que son père a passé sa vie à rechercher un ancien nazi qui l'avait persécuté à Auschwitz. Pas très motivé au départ, la rock star maquillée, empotée, les bras couverts de bracelets, les mains de bagues à chaque doigt, physique à la Alice Cooper, se lance dans un road-movie avec le pick up d'un tiers. Bien évidemment, c'est lui-même adulte qu'il va trouver au bout du chemin.
Grande déception pour l'interprétation de Sean Penn qui prend toute la place (ce qui n'est pas le problème) adoptant la gestuelle et la voix chevrotante d'une vieille dame, ses postures coincées, ses gestes étriqués, avec le tic de souffler sur une mèche de sa perruque, il en fait des tonnes. Où est le génie de l'intériorisation? Cette performance d'acteur taillée pour les Oscar m'a accablée... David Byrne, auteur de “This must be the place”, a composé la musique du film où il joue son propre rôle.
 Sean Penn sur les marches vendredi soir
Sean Penn sur les marches vendredi soir
Sean Penn sur la Croisette :
A Cannes depuis quelques jours, Sean Penn n'avait pas eu envie d'aller à la conférence de presse de "L'Arbre de vie" de Malick dans lequel il joue quelques minutes (après montage) mais avait monté les marches avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Hier, il a assisté à la conférence de presse et au photocall de "This must be the place" avec un air bougon, peu loquace. Quand il a monté les marches à la séance de 19h30, il était plus détendu, des femmes fans hurlaient toutes en coeur des "Seannnnn" tonitruants.


Sean Penn à Cannes/mai 2011 (photos Isabelle Vautier)

Sean Penn et son fils (photo Isabelle Vautier)
"Drive" de Nicolas Winding Refn
(sortie 5 octobre 2011)
Pitch.
Cascadeur le jour, chauffeur pour la mafia la nuit, the driver fait la connaissance d'une jeune femme et de son fils, ses voisins de palier. Pour les protéger, il accepte de conduire un braquage avec son mari qui sort de prison avec des dettes.
Le film aurait dû s'appeler The Driver mais c'était déjà pris (un film américain avec Isabelle Adjani). Débarqué un jour dans un garage, le gérant, Shannon, bluffé par ses talents au volant, devient le manager du driver. Solitaire, mutique, le driver est cascadeur sur des tournages de LA durant le jour, chauffeur pour des truands la nuit. Avec un code de conduite strict : ne pas participer aux casses, s'en tenir à conduire.
Un jour, Shannon propose à Bernie Rose, un mafioso notoire, d'investir dans un nouveau véhicule afin que le driver puisse participer à des courses de stock-car où il ne doute pas qu'il sera le meilleur. Rose hésite puis accepte si on met son associé, Nino, dans le coup. Au même moment, le driver qui vient d'emménager, craque pour sa voisine de palier, Irene, et son petit garçon, Benicio. Quelques temps plus tard, le mari d'Irene sort de prison avec une dette vis à vis de voyous qui le tabassent et menaçent de s'en prendre à sa famille. Pour protéger Irene et son fils, le driver accepte de faire un casse avec son mari mais l'affaire est un piège.
Sur une BO assez géniale correspondant aux airs qu'écoute le driver dans sa voiture, le film est sobre, parfois très violent, rythmé, porté par l'interprétation hors norme de Ryan Gosling, sorte de "Samouraï" blond qu'un amour platonique pour sa voisine conduit à mettre en danger une vie règlée au millimètre. Portrait d'un homme seul, un cow-boy des villes, portrait d'une ville impitoyable, LA, filmée comme un objet de désir. Un prix d'interprétation pour Ryan Gosling serait amplement mérité et on devrait retrouver ce film au palmarès.

 sortie de la projection de "Drive" vendredi soir, à droite, Thierry Frémeaux et Ryan Gosling
sortie de la projection de "Drive" vendredi soir, à droite, Thierry Frémeaux et Ryan Gosling

 Ryan Gosling/ Nicolas Winding Refn et Ryan Gosling à Cannes/mai 2011 (photos Isabelle Vautier)
Ryan Gosling/ Nicolas Winding Refn et Ryan Gosling à Cannes/mai 2011 (photos Isabelle Vautier)

 Malcom Mc Dowell a donné la Master Class cette année à Cannes vendredi à 14h
Malcom Mc Dowell a donné la Master Class cette année à Cannes vendredi à 14h
La veille, Cannes Classics a programmé la reprise d'"Orange mécanique"
 dernière soirée à Cannes...
dernière soirée à Cannes... ,
This must be the place,
Paolo Sorrentino,
Drive,
Nicolas Winding Refn
19 - 05
2011


Hier, avant-dernier jour, à Cannes, j'ai toujours l'impression que j'aime Paris, hâte de rentrer... Pourtant, hier, sous un cagnard qui n'a jamais cessé depuis le début du festival, j'arrache une invit sur le tapis rouge pour Almodovar 14h30, les dames d'à côté sur le tapis sont furax parce que je n'ai pas de pancarte comme elles qui restent immobiles en la tenant à bout de bras, je vais et viens, je demande aux festivaliers en français, en anglais, s'ils n'ont pas une invitation "en trop"? Je vais m'installer plus loin, ça me porte chance, je décroche deux invit dont l'une à l'orchestre, le ticket orchestre bleu, c'est le rêve, pas besoin de pass, accueil VIP, toilettes en nombre, rien à voir avec le balcon interdit aux sujets au vertige, son escalier, ses marches, son accès aux toilettes barré après la projection, et, s'agissant des invit marron, les pass cinéphiles, encore une fois, n'y ont pas droit, le marron demande un pass festival minimum...
Soirée sans film mais avec 60 critiques de cinéma experts à l'espace Pantiero Canal+ , c'est le diner du "Cercle" de Canal+Cinéma auquel sont conviés, outre les chroniqueurs de l'émission comme Xavier Leherpeur, Marie Sauvion et Sophie Grassin, sous la houlette de Frédéric Beigbeider, un peu tous les journalistes ciné "qui comptent". L'un d'entre eux m'accompagne à une table en me disant "vous verrez, ils sont sympa!" et c'est vrai que j'ai été très bien accueillie, installée avec les représentants de Première, Télérama (Jacques Morice), Télé2Semaines, VSD, les correspondants du Nouvel Obs à LA, etc... Les critiques ciné TVmédiatisés, plus "stars", genre Philippe Rouyer ("Positif") intervenant au "Cercle", dont on entend la voix puissante très caractéristique depuis la table voisine, ont tendance à rester entre eux, à préparer leurs émissions à venir, ça bosse encore, mine de rien, avec champagne rosé et saumon froid en gelée, on parle ciné...
"La Piel que habito" de Pedro Almodovar
Pitch.
Un chirurgien esthétique se perd dans des recherches pour trouver une nouvelle peau qui résiste à tout après la mort de son épouse carbonisée dans un accident de voiture dont il se dit qu'il aurait pu la sauver.
Ce qui ennuyeux quand on se lance dans la confection d'un thriller horrifique, c'est qu'il n'y ait à la sortie ni suspense ni angoisse, c'est le cas de "La Piel que habito" qu'Almodovar a adapté librement d'un roman français ("Mygale de Thierry Jonquet). Très vite, les obsessions du réalisateur prenent le dessus, les histoires de famille, les complications sexuelles, les comportements hystériques, etc... Et question famille, il met le paquet! L'amateur de thrillers risque bien de s'ennuyer ferme dans ce récit ultra-descriptif, surexplicatif, où tout est montré quand on sait que l'angoisse se met en scène idéalement hors champ. La référence aux "Yeux sans visage" de Franju, film franchement terrifiant, beaucoup plus limpide, est alors erronée, excepté si l'on s'en tient à la lecture du synopsis.
Un chirurgien esthétique de renom, Robert Ledgard, s'est spécialisé dans la recherche sur la peau de synthèse après la mort de son épouse, Gal, carbonisée dans un accident de voiture 7 ans auparavant. Des travaux de recherche qui ne s'accordent pas avec l'éthique, il va sans dire. Dans le secret, il détient emprisonnée chez lui, une villa immense et surchargée de tableaux, une sorte de sosie de sa femme, une certaine Vera, qu'on découvre faisant du yoga dans une combinaison en latex et dont on comprend tout de suite qu'elle est une créature de synthèse avec une peau, fruit des recherches du professeur Ledgard, savant devenu fou. Une seule compagnie pour Robert et Vera, la gouvernante qui en sait long sur tout et tout le monde... Dont le fils disparu va revenir frapper à la porte déguisé en tigre (c'est le carnaval à Madrid)... Un voyou qui se jette sur Vera en la prenant pour Gal qui n'était donc pas aussi fidèle à Robert qu'on aurait pu le supposer...
Frénésie sexuelle, opérations transexuelles, secrets de famille, folie, Almodovar compile ici un peu tout son univers, des premiers aux derniers films, le tout avec un calme clinique glacé puisqu'il s'agit d'un médecin, ça l'impressionne on dirait! Mais pas au point de renoncer au mélo pour le thriller fantastique qu'on était en droit d'attendre... Le film de genre pour Pedro? Une occasion de dériver vers des histoires de filiation transgressive... Le point positif, Antonio Banderas, à qui Almodovar aurait interdit de sourire pendant le tournage, est très bien, nettement supérieur à ses prestations américaines.
Mots-clés : Cannes 2011,
La Piel que habito,
Pedro Almodovar
18 - 05
2011

Malgré les déclarations provocatrices de Lars Von Trier en conférence de presse, notamment antisémites qui l'ont conduit à s'excuser publiquement, la salle était bondée hier soir à 22h30 pour la présentation officielle de "Melancholia", récit allégorique de la propre dépression nerveuse du réalisateur. Peu ont applaudi mais peu sont sortis de la salle pendant la projection... Merci à mon blogueur préféré de m'avoir permis de voir le film dans de bonnes conditions...
"Melancholia" de Lars Von Trier
Pitch.
Le jour de son mariage, durant une réception luxueuse dans le chateau de son beau-frère, une jeune femme craque et plonge dans la dépression. Pendant ce temps, la planète Melancholia s'approche dangereusement de la terre.
Avant le générique, tout est dit, tout est montré, la mariée gisant dans l'eau, la collision de la terre avec la planète Melancholia, etc... Le jour de son mariage, Justine (Kirsten Dunst) sourit trop, a un air heureux qu'on dirait un brin forcé. Mais elle va cesser de se forcer quand sa mère (Charlotte Rampling), excentrique et dure, fait une déclaration aigre à la table de réception. Une réception fastueuse organisée dans la maison de sa soeur Claire (Charlotte Gainsbourg) et son riche beau-frère (Kiefer Sutherland) d'où elle s'échappe. Elle et sa mère vont prendre un bain en plein dîner... Le père, futile, danse comme une toupie.
Deux parties dans ce film qui est une brillante démonstration allégorique de la dépression nerveuse : deux soeurs, Justine et Claire, la blonde polaire et la brune solaire... Justine est incapable de vivre, engourdie physiquement, asphyxiée musculairement par une forme aigüe de dépression nerveuse, la mélancolie ; Claire est le versant angoisse de cette dépression, terrorisée par la peur de mourir, elle ne cesse de consulter internet pour lire les prédictions des experts scientifiques quant à la véracité de cette menace que la planète Melancholia rentre en collision avec la terre.
L'une n'aime pas la vie, l'autre a peur de la mort, c'est le conflit des deux versants d'un état psychique où il serait trop confortable de s'en tenir à la position de Justine, la somatisation d'un mal intérieur qui vous rend indifférent à presque tout car "Madame angoisse" (comme l'appelait la fille de Simenon, qui s'est suicidée, dans un livre posthume que son père a fait publier) ne vous lâche pas. Justine, lors de la réception de mariage, essaie vainement d'appeler à l'aide des "sourds", sa mère, son père, son mari, sa soeur, aucun n'a le temps de lui répondre. Les hommes de la vie des deux soeurs, Justine et Claire, vont être balayés en deux temps trois mouvements, le mari démisssionne, le beau-frère est recouvert de paille après un accident dans une écurie, des hommes aimants mais idiots, trop réels, "équilibrés", inutiles.
Il y a dans ce film un mélange de naïveté et de poésie, un parti pris symphonique un peu lourd parfois (Wagner) ; certaines scènes superbes comme Justine nue au clair de lune qui la balaye en noir et blanc. Kirsten Dunst est magnifique et mériterait amplement le prix d'interprétation.
"L'Apollonide" de Bertrand Bonello
photo Haut et Court / sortie 21 septembre 2011
Pitch.
A l'aube du XX° siècle, une prostituée d'une maison close haut de gamme est défigurée par un client, l'après accident sonne le début de la fin. Portrait de l'intérieur d'un lieu clos où les prostituées vivent un peu comme des pensionnaires et partagent leurs espoirs et désespoirs.
Ces souvenirs de la maison close l'Apollonide sont lugubres, je ne vois pas d'autre mot. Dans des décors d'époque (XIX°), des robes très belles, des personnages crédibles de prostituées pensionnaires de la maison close, on filme des instants de vie sur deux époques, avant l'accident vers 1890, et après vers 1900. L'accident, c'est la synthèse d'un certain nombre de références, encore un homme avec un petite boite, comme celle du japonais de Madame Anaïs dans "Belle de jour" qui terrifie les prostituées, mais ici, on a affaire à un client, apparemment schizophrène, qui va défigurer une prostituée qu'il connaît bien, dont il est un "habitué" pour lequel elle a des sentiments forts, après qu'elle lui ait raconté un rêve précis, une blessure typiquement "Dalhia noir", la tension monte quand elle lui propose de le rejoindre dans une chambre aux rideaux noirs. La blessure atroce lui ouvre une bouche immense d'une oreille à l'autre, la carrière de Madeleine, dit "la juive", est finie.
Ensuite, seconde époque, c'est le début de la fin, la prostituée centrale est devenue trop vieille (28 ans), le notaire propriétaire des murs de la maison close veut augmenter le loyer dans des proportions drastiques, la "Madame" (Noémie L) ne peut plus payer. On poursuit les allers et retours avec la belle époque de l'Apollonide au fait de sa gloire, ses prostituées chics, propres, subissant des contrôles de santé, son ambiance pensionnat des toutes ces filles ensemble sympa les unes avec les autres, rêvant qu'un client rachète leurs dettes et les épouse.
Comme on pourrait le dire de bien d'autres films en ce moment, le film une longue succession de tableaux qui dure deux heures, avec un souci réaliste de montrer l'intimité des prostituées quand elles se lavent, tentent de désinfecter leur corps, dorment ensemble après les nuits avec des clients, fument de l'opium pour tenir le coup. Le fil narratif, c'est donc Madeleine, la prostituée défigurée qu'on finira, pour renflouer la maison close en faillite, par louer très cher dans des orgies huppées où des grandes bourgeoises veulent des monstres. Mais pourquoi tous ces films sont-ils d'autant plus longs qu'il n'y a pas grand chose à raconter?
"Hanezu" de Naomi Kawase

photo Memento
Pitch.
Dans la région d'Asuka, à Nara, berceau du Japon, deux générations s'affrontent par images interposées : les anciens qui avaient le plaisir de l'attente des évènements extérieurs, les modernes qui veulent régenter rapidement leur vie.
Le film compare deux générations, celles d'autrefois qui se satisfaisaient de l'attente, y trouvaient du plaisir, et celles d'aujourd'hui, ayant perdu le sens de l'attente, incapables de profiter du présent, s'accrochant à l'illusion qu'ils ont le pouvoir de diriger les choses, les évènements. La réalisatrice montre surtout la nature mais deux natures, celle de la région d'Akusa, à Nara, le berceau culturel du Japon, où réside la réalisatrice : avec trois montagnes qu'on disait jadis habitées par des dieux, considérées comme l'expression du karma humain. Les montagnes sont toujours là mais le couple moderne Takumi et Kayoto, qui habitent la région, héritiers des espoirs non réalisés de leur ancêtres, passent à côté de leur vie.
Hanezu est un mot ancien apparu dans la poésie japonaise du 8° siècle (Manyoshu) riche de 4500 poèmes, il signifie un ton de rouge. Or, il a été dit que le rouge est la première couleur que reconnaît l'être humain, la couleur du sang, du soleil, du feu. Néanmoins, le rouge est fragile, s'affadit, se décolore, on le voit dès le début du film quand Takumi teint un tissu avec une teinture rouge cerise, dont on se demande, à première vue, si c'est du sang ou du colorant, et fait sécher ensuite des étoffes à rosées et pas rouges. Et le sang d'un homme brisé coulera vers la fin du film...
Un homme et une femme qui en aime un autre, l'avoue enfin bien tardivement, le conduit au désespoir. Pas sécurisée par l'autre homme, cette femme lui fait croire qu'elle a avorté de leur enfant qu'elle portait, l'homme hurle sa douleur. Adéquation entre les liquides naturels et corporels, la pluie, les larmes, la lave, le sang, etc...
PS. je complèterai ces critiques rapides plus tard...
Mots-clés : Cannes 2011,
Melancholia,
Lars Von Trier,
L'Apollonide,
Bertrand Bonello,
Hanezu,
Naomi Kawase
17 - 05
2011

Hommage à Belmondo hier mardi avec une palme d'or honorifique remise par Gilles Jacob, la présence tous ses copains du conservatoire encore vivants (Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Pierre Vernier), un documentaire "Belmondo, itinéraire", projeté simultanément à Cannes et sur France 2. On y voit fugacement le témoignage d'une Marie-France Pisier un peu éteinte, sa partenaire dans "Le Corps de mon ennemi" d'Henri Verneuil (1976) (film magnifique méconnu où elle joue une riche héritière amoureuse d'un Bébel, gendre idéal, puis, scandaleux, qu'une ville bien-pensante, pervertie et sous la coupe d'un grand industriel/Bernard Blier, va adouber puis honnir quand il ouvre une boite de nuit un peu spéciale) ; sa partenaire aussi dans "L'As des as" que Bebel surnommait "Marie-France, la star de la cinémathèque".

Marie-France Pisier et Jean-Paul Belmondo dans "Le Corps de mon ennemi"
Une journée de mardi plus sympa que la veille où, voulant rattraper "Michael" (compétition) dans une salle du marché, soudain, on décide "Buyers only", j'objecte que ce n'était pas mentionné sur le programme très pointilleux là-dessus. En pratique, entre les amis et les acheteurs, comme la salle ne fait que 67 places, je reste sur le carreau. J'enchaîne par un brin de shopping dans une rue à étiquette "chic" derrière la Croisette, me fait suivre et insulter par deux types désoeuvrés, ne sachant que faire, me réfugie au bar de l'hôtel Gray d'Albion où règne luxe et volupté, petits fauteuils en cuir doré mat et service raffiné. Heureusement, une invitation de dernière minute à la soirée des Magritte du cinéma belge, équivalent de nos César, avec concert privé sur le toit du Radisson, hôtel spa luxueux installé sur le vieux port, qui domine toute la baie de Cannes, me change les idées, c'est bondé mais le public est quinze fois plus chic que sur les plages et la musique top, je dévouvre la scène belge (Selah Sue et Puggy).


Magritte du cinéma belge et concert privé Selah Sue
 Puggy (toit du Radisson hotel lundi 16 mai 2011)
Puggy (toit du Radisson hotel lundi 16 mai 2011)

Mardi donc, hier, deux films en compétition pas très excitants sur le papier et pourtant! Le premier, "Le Havre", tourné en France avec des acteurs français par le réalisateur finlandais Aki Kaurismäki, réalisateur phare des années 90, le second, "Pater" du doyen de la compétition, Alain Cavalier, film annoncé "une des choses les plus bizarres de l'histoire du cinéma" de la voix même du sélectionneur à la conférence de presse de la sélection officielle en avril. A la sortie, deux succès, excellent accueil pour le "Le Havre", ovation pour "Pater" qui a tout de même découragé un bon quart de la salle pendant la projection. Mais ceux qui sont restés ont aimé au delà de la mesure. On parle même d'une palme...
"Le Havre" d'Aki Kaurismäki
 photo Pyramide
photo Pyramide
Pitch.
Un ex-écrivain bohème, exilé au Havre où il exerce la profession de cireur de chaussures, est amené à cacher un adolescent dont la famille vient d'être arrêtée avec un camion d'immigrés clandestins.
Deux cireurs de chaussures au Havre, Chang, travailleur sans papiers depuis douze ans, et Marcel Marx, ancien écrivain, bohème patenté dont l'épouse, Arletty, très malade, épargne son irresponsable de mari en minimisant les choses. Hospitalisée, Arletty obtient du médecin qu'il ne dise pas à Marcel qu'elle est condamnée. Marcel ne gagnant pas grand chose de ce nouveau métier, les commerçants du quartier dont la boulangère, lui font crédit plus ou moins volontiers. Un jour, la police du Havre arrête un camion d'immigrés clandestins africains, un gamin réussit à fuir et se cacher. Comme dans "Welcome" mais dans un ton radicalement opposé, Marcel, perdu sans sa femme, va recueillir Idrissa, l'adolescent, le dissimuler à la police et réunir l'argent pour essayer de le faire passer à Londres. Pour cela, il convainc la chanteur Little Bob de donner un concert (superbe BO).
Parmi les personnages hyperstylisés s'exprimant de manière distanciée, le commissaire de police Monet est interprété par Jean-Pierre Darroussin qui réussit toujours à faire passer un naturel extraordinaire même dans des rôles de composition, ici, pardessus et chapeau noir, physionomie rigide. Les lieux de prédilection de Marcel sont toujours les mêmes : le bistrot, la boulangerie, l'épicerie, décors de cinéma colorés et montrés comme tels par le réalisateur.
L'univers de Kaurismäki est inchangé, personnages, costumes et décors très stylisés, dialogues surécrits, très châtiés (des subjonctifs), humour et décalage, composition raffinée des plans. Mais ici, malgré un sujet d'actualité difficile, l'immigration clandestine, le propos est paradoxalement optimiste, un conte politique traité de manière non réaliste, un récit pavé de bons sentiments. On est content de retrouver Jean-Pierre Léaud dans un petit rôle de collabo, lui qui avait le rôle principal dans un des premiers films de Kaurismäki distribué en France "J'ai engagé un tueur" (1990), sans doute l'acteur dont le jeu colle le mieux à son univers.
"Pater" d'Alain Cavalier

 photo Pathé
sortie 22 juin 2011
photo Pathé
sortie 22 juin 2011
Pitch.
Un réalisateur et un comédien. Ils cherchent un film à tourner ensemble. Jouer au président et à son premier ministre. Le film les montre dans la vie et dans cette fiction qu'ils inventent ensemble.
Alain Cavalier et Vincent Lindon, amis dans la vie avec une relation de type filial, se demandent tout en partageant des petits plats et autres plaisirs quotidiens, quel film ils pourraient faire ensemble, par exemple, jouer aux hommes de pouvoir, le premier président choisissant le second comme premier ministre lui proposant un programme qu'ils potassent ensemble.
L'occasion de faire un procès très drôle mais sans concession de notre société sur le ton "café du commerce" : les hommes d'affaires qui émigrent hors de France ne devraient pas avoir droit à la sécurité sociale et rendre leur légion d'honneur, le syndic de Vincent se couche devant la société d'un styliste célèbre mais le force à payer un ascenseur dont il n'a pas besoin, le salaire minimum, c'est bien, le salaire maximum ça serait bien aussi... Les liftings à 3000 Euros, l'unique valeur pognon de la jeunesse, les vêtements hors de prix payés par la production du film, tout y passe...
Mélange de fabrication du cinéma et de cinéma lui-même, on ne pose pas la limite, les deux s'appelant toujours Alain et Vincent, qu'ils soient dans la préparation d'un film pour lequel ils cherchent des idées ou dans un jeu de rôles. Alain Cavalier et Vincent Lindon jouent tour à tour leurs propres rôles et le tandem président/premier ministre, cette fiction absurde "pour rire" qu'ils ne tourneront pas ou plutôt qui s'intègre à cet OFNI, ce drôle de portrait double. On joue aux hommes de pouvoir, les hommes de pouvoir jouent aussi, quand est-ce qu'on cesse de jouer? La vie est un théâtre. Vincent Lindon est extraordinaire dans ce film, je ne le croyais pas capable d'une telle performance toute en nuances.
PS. Le film est tellement peu facilement descriptible que je recopie ci-dessous l'extrait d'un dossier de presse qui est quasiment vide :
Vincent Lindon et Alain Cavalier, liés par l’amitié, presque comme fils et père. Boire du Porto dans les bars, se demander quel film on peut faire ensemble. De temps en temps, mettre une cravate et un costume. Se filmer en hommes de pouvoir. Histoire de voir jusqu’où on peut mettre les pieds dans le plat. Histoire de rire. Histoire à dormir debout, si on confond histoire personnelle et histoire tout court. Et toujours, la bonne question sans réponse du cinéma : est-ce vrai ou pas ?
Mots-clés : Cannes 2011,
Le Havre,
Aki Kaurismäki,
Pater,
Alain Cavalier
15 - 05
2011

Premier film présenté en compétition jeudi, je ne l'ai vu qu'hier dimanche en reprise, ce qui va être le lot de ce 64° festival de Cannes en essayant cette année de privilégier les films aux marches et autres événements du jour, l'accréditation du marché de film me permettant d'avoir accès à plusieurs séances de rattrapage...
"Sleeping beauty" de Julia Leigh

Pitch.
Une jeune étudiante répond à une annonce pour réjoindre un réseau de prostitution où elle accepte de jouer la vierge endormie avec des hommes âgés, le lendemain de ces nuits tarifiées, elle ne souvient de rien mais tout a pu arriver.
Supervisé par Jane Campion, seule femme Palme d'or, "Sleeping beauty" est le premier long-métrage de la romancière australienne Julia Leigh. Le film se présente comme un conte érotique triste, parfois désespéré, où une jeune fille, Lucy, vivotant de petits boulots le jour, habitant chez une soeur et un beau-frère hostiles, se prostituant déjà plus ou moins dans des boites de luxe la nuit, rejoint un réseau de prostitution un peu particulier sous la houlette d'une certaine Clara qui vend les services de jeunes fausses vierges endormies à des hommes riches vieillissants impuissants.
Rebaptisée Sarah par Clara, la jeune fille, que tout dans la vie semble laisser de marbre, dans une sorte d'acceptation agressive de ce qui arrive, mélange de dureté et de passivité, accepte les missions dans une maison isolée. Une chose, une personne émeut Clara, un ami toxicomane condamné qu'elle va voir régulièrement, le seul être humain avec qui elle accepte l'émotion, qu'elle accompagnera jusqu'au bout.
Si la première partie du film montre une Lucy plutôt victime, faisant le ménage dans un restaurant, des photocopies dans un bureau, la seconde partie du film est consacrée à la prostitution de Lucy/Sarah endormie, à la fois puissante et passive, amnésique au matin de ce qu'on a pu lui faire la nuit. Rituel immuable avec Clara qui prépare la tisane soporifique avec son petit balai à thé, Sarah qui la rejoint en peignoir de velours mauve et boit le thé fatal, Sarah endormie dans un grand lit qu'on présente dans un halo blanc, la peau blanche, comme dans un rêve, que rejoint dans "la chambre" un homme différent à chaque fois. Un homme vieux, trop bronzé, encore musclé sous la peau ridée, un autre... Tous ces hommes ont déjà été vus ensemble dans une scène prélalable d'orgie blanche où une troupe de serveuses assez spéciales en tenues genre SM noires fait le service à table, Lucy/Sarah en blanc versant le vin. Et déjà dans cette scène, les personnalités se sont dessinées qui vont se révéler dans "la chambre" plus tard, cet homme chauve qui fait tomber Lucy/Sarah par plaisir. Cet homme élégant qui parle de son épouse défunte Elisabeth.
Le problème avec ce genre de film, c'est le mélange d'un certain réalisme moderne dans la caractérisation du personnage de Lucy et du choix de montrer également les choses sous l'angle d'un conte où tout serait rêvé, ressenti, fantasmé, jamais vrai, jamais faux, entre réalité et imaginaire. Il semble que la réalisatrice, d'une part, fasse référence à sa jeunesse où elle vivait avec l'idée de la mort, avec des amis toxicomanes qui se sont suicidé, d'autre part, la romancière, littéraire, se réclame d'écrivains comme Bataille.
Emily Browning, qui avait refusé le rôle de Bella dans "Twilight", a été vue récemment au cinéma dans "Sucker punch". C'est une Lucy livide perverse, peau diaphane, cheveux blond vénitien, regard de pierre dure, colère contenue dans un hypercontrôle devenu indifférence apparente à tout, subissant ou plutôt choisissant de subir (contre de l'argent et un plus érotique mystérieux) dans le cadre du réseau des "sleeping beauties" puisqu'il faut de toute façon supporter son statut de victime dans la société.
Un conte sexuel tendance Bunuel (Lucy, la nouvelle Sévérine? Que fait-on à Lucy la nuit? On pense à la scène de "Belle de jour" dans la maison close de Madame Anaïs avec le japonais que tout le monde craint sauf Séverine qui accepte le "jeu" contenu dans une boite qu'il transporte avec lui, on ne sait pas quel jeu, ce que contient cette boite, ensuite, la femme de chambre la plaint de supporter tout ça et elle lui répond "qu'est-ce que tu en sais?"). Un conte sexuel désincarné, très littéraire, où rien n'est montré, tout est suggéré, où on passe du silence au très long monologue d'un homme brisé. Mais un conte pour dire quoi hormis le portrait de Lucy si intéressant soit-il? Le récit en soi ne va nulle part, le film reste creux, bien que troublant, succession de scènes peintes comme des "tableaux", volontairement sans approche psychologique pour conserver le mystère qu'on voudrait abyssal du personnage Lucy, bien réalisé, comme un écrin pour un personnage unique.
 photo ARP Sélection
photo ARP Sélection
clés :
sous-titre du film :
"Ce que les hommes lui font la nuit, elle ne s'en souvient pas quand le jour se lève"...
dans une interview de Julia Leigh à Télérama :
de Lucy, elle dit "... elle-même est possédée par une forme de provocation perverse à l’égard du monde. Mais jusqu’où est-elle prête à aller ?
Mots-clés : Cannes 2011,
Sleeping beauty,
Julia Leigh
14 - 05
2011


Un samedi à Cannes avec "Michael", une séance unique, en compétition, film autrichien sur les relations entre un pédophile "ordinaire" et sa victime, avec le 4° volet de "Pirate des Caraïbes" (sortie le 18 mai en salles) qui a occupé l'heure chic sur les marches (autour de 19h), ce qui m'a donné l'occasion de voir off (enfin!) Robert de Niro et Jude Law, tous deux au jury dont la plupart des membres sortaient discrètement après le générique : Olivier Assayas, Martina Gusman et, même, hors jury mais à l'affiche du film avec Johnny Depp, la jeune et jolie Astrid Berges-Frisbey qui a du mal avec les photographes en grand nombre à la sortie, elle n'ose pas monter dans sa voiture, son staff la ramène vers l'intérieur du bâtiment.
Pendant ce temps, je fais du rattrapage. Un film mexicain, dans la section Un Certain regard, sur les cartels de la drogue "Miss Bala" focalisé sur une victime expiatoire qu'on balade tout le long du film piégée, manipulée, utilisée par tout le monde, les voyous, les flics, les politiques. Candidate sélectionnée à une élection de Miss beauté, Miss Baya California, prise dans une fusillade avec une copine en allant fêter ça au "Millenium", une boite sordide en sous-sol, une jeune fille est prise en otage par des truands du cartel Estrella parce qu'elle a vu ce qu'elle ne devait pas voir. Quelques fusillades réalistes et le calvaire de cette jeune femme symbole de tous les personnages qu'on ne voit pas (parti pris d'auteur), un film chaud et froid.
Pour une fois que je ne m'étais pas habillée pour monter les marches avec le dress code imposé "soir", un couple me donne deux invit pour "Footnote" de Joseph Cedar en compétition qui n'a pas l'air d'intéresser grand monde... Et je m'en vais salle Bunuel voir la reprise d'"Habemus papam" de Nanni Moretti, ici, c'est bondé, mais une heure d'attente décourage pas mal de monde et j'arrive à rentrer dans les derniers. Cannes, on ne sait jamais si on arrivera à voir un film tant qu'on n'est pas assis dans la salle, et encore! pour Cannes Classics "Portrait d'une enfant gâtée", la copie ne marchant pas, on a dû s'y reprendre à trois fois, le projectionniste à deux doigts d'abdiquer.
"Habemus papam" de Nanni Moretti
 sortie 7 septembre 2011
sortie 7 septembre 2011
Tragicomédie parfaite dont seuls les italiens ont le secret, "Habemus papam" pourrait bien figurer au palmarès. Drôle, original, subtil, c'est du grand Moretti qui interprète ici un psychanalyste appelé en renfort pour assister le nouveau pape démissionnaire. Après trois tours de vote, un pape français, Melville, outsider, est élu. L'élection du pape par les cardinaux est en soi un grand moment de bravoure, la TV ridiculisée, la panne d'électricité, un cardinal tombe de sa chaise..., les pensées à voix haute des cardinaux qui prient pour ne pas être élus, les deux premiers tours de vote où jamais Melville n'est voté...
Le cardinal Melville (Michel Piccoli), élu contre toute attente, s'effondre avant de parvenir à saluer au balcon la foule de fidèles amassée sur la place Saint Pierre... Son porte-parole fait venir un psychanalyste qu'il oblige à habiter au Vatican, coupé du monde, et fait croire aux cardinaux que le pape se repose quand ce dernier a fait une fugue en ville... Le psychanalyste organise un tournoi de volley avec les cardinaux pour soutenir le moral des troupes, en ville, le pape, dont personne ne connait même le nom, encore moins le visage (les séquences TV sur les supputations des journalistes sont savoureuses), s'adonne à sa passion refoulée, le théâtre...
Avec une apparente simplicité, Nanni Moretti livre ici un film superbe, aussi drôle que tragique, sur la destinée, les regrets, l'impuissance, les rêves enfouis des plus grands de ce monde. Grand coup de coeur papal!
 Robert de Niro
Robert de Niro
 Jude Law
Jude Law






 Clovis Cornillac et sa compagne
Clovis Cornillac et sa compagne

 Clovis Cornillac, Olivia Bonamy / Uma Thurman
Clovis Cornillac, Olivia Bonamy / Uma Thurman Mots-clés : Cannes 2011,
Habemus papam,
Nanni Moretti
13 - 05
2011


Il semble que ce soit un cas un peu particulier, "Hanezu" de Naomi Kawase, le film japonais en compétition en sélection officielle, qui sera présenté mercredi prochain au grand théâtre Lumière, a été projeté hier vendredi 13 mai (jour porte-bonheur pour certains superstitieux inversés) au cinéma des Arcades plusieurs jours avant sa présentation à la presse. J'inaugure donc une projection dans une salle du marché du film, hors circuit du palais des festivals, barrières, vigiles, contrôles, et tutti quanti... Mais le ton n'est pas tellement plus détendu pour autant. Assise au café mitoyen, je ne vois personne faire la queue pour la projection, j'y vais d'un pas promenade, soudain, une file se forme, inutilement, on va le voir, car la préposée du distributeur arrive avec un sourire ensoleillé pour les uns, un ton frisquet pour les autres, demander les cartes professionnelles de chacun en échange d'un dossier sur le film. A moi, par exemple, "vous êtes au courant qu'il y a un embargo? vous savez ce que c'est? vous allez le respecter?" (moi, réponse) "si on me le demande, je le ferai sans problème". Sur ce, madame distribution va chercher de par derrière la file quantité de badges du marché du film les plus gradés avec une barre rouge par dessous le bleu sur leur pass, et quelques connaissances aussi, pour les faire entrer en priorité, et un vigile enjoint le commun du marché à rejoindre la file d'attente. Finalement, je rentre, il reste quelques places dans cette salle qui n'est pas immense (142 places). Et qui va se vider consciencieusement d'un bon tiers de l'auditoire pendant la projection... A Cannes, il semble qu'on ne sache jamais si on va pouvoir entrer voir un film, c'est une sorte de suspense... Donc! je parlerai du film mercredi 18 mai...

Naomi Kawase
Caméra d'Or en 1997 pour "Suzaku", Grand Prix du jury 2007 pour "La Forêt de Mogari", la photographe, documentariste et réalisatrice Naomi Kawase figure pour la troisième fois en sélection officielle à Cannes avec "Hanezu" .
Mots-clés : Cannes 2011,
Hanezu,
Naomi Kawase
12 - 05
2011

J'inaugure un festival de Cannes plus zen que les années précédentes où je passais mes journées à courir faire de la retape sur le tapis rouge et mes nuits à écrire sur mon blog. Aujourd'hui, mon hôtel étant sur le vieux port, je visite, je flane rue Meynadier dans la vieille ville avant d'arriver près du palais des festivals, je retourne néanmoins pratiquer le sport cannois le plus prisé du festival pour demander une invit pour la séance de 15h, les festivaliers sont agacés de ces demandes, ces pancartes, on n'est pas moins gêné mais ça marche souvent, au bout d'un quart d'heure, j'abandonne l'aile Debussy pour l'aile Croisette (les invités entrent des deux cotés du tapis rouge) et une dame me donne un ticket bleu corbeille. Le film "We need to talk about Kevin" de la réalisatrice anglaise Lynne Ramsay : un red nightmare sur red carpet, la symbolique rouge envahissant l'écran.

 Thierry Frémeaux, Jerry Schatzberg, Faye Dunaway
Thierry Frémeaux, Jerry Schatzberg, Faye Dunaway

La soirée du jeudi 12 mai était celle des ouvertures de toutes les sections parallèles comme la Semaine de la critique avec "La Guerre est déclarée" de Valérie Donzelli. Pour ma part, le choix était fait depuis Paris : "Portrait d'une enfant déchue" de Jerry Schatzberg avec Faye Dunaway, tous deux présents à la salle du 60° anniversaire bondée avec des invités de marque comme Fatih Akin ou Pierre Rissient, Michel Ciment, auteur du seul livre français sur Jerry Schartzberg. Malheureusement, le son est mauvais, les gens protestent bruyamment, beaucoup plus dérangeants encore que le son. On s'y reprend à trois fois avant de montrer la même version sonore que lors des deux premiers essais. J'ai déjà fait un article ici pour présenter le film... Le résultat est assez indescriptible.
"Puzzle of a Downfall Child" ("Portrait d'une enfant déchue" (1971) de Jerry Schaztberg
 photo Carlotta
photo Carlotta
Un photographe de mode va voir un ancien top model retirée dans une maison isolée sur la plage afin de mener à bien une série d'interviews préalables à la réalisation d'un film sur sa vie. Le film fait le va et vient entre présent et passé mais pas un passé souvenir, plutôts des souvenirs fantasmés du passé telle qu'elle l'a perçu, occulté parfois comme cette image de l'homme plus âgé quand elle avait quinze ans. Lou-Andreas Sand (nom emprunté à Lou-Andreas Salomé) s'appelait Emily et même Aaron Reinhardt, le photographe n'en savait rien. Les débuts de Lou comme mannequin, l'amitié ambigüe avec Pauline Galba, la photographe excentrique mariée à un médecin, le mariage avec Mark (Roy Scheider), l'hôpital psychiatrique, et, récurrentes, les relations d'amitié amoureuses entre Lou et Aaron, son seul ami, marié à une autre. Faye Dunaway est assez extraordinaire dans ce film dont elle est le centre absolu. Bien que Jerry Schwatzberg soit un ancien photographe de mode, bien que film traite de la relation entre un photographe et un mannequin, l'histoire parle très peu de mode mais plutôt de la chute d'une femme trop belle, n'existant que part son apparence, seule, fragile, en prise avec ses démons intérieurs.
Les marques de boissons occupant pas mal de plages privatisées durant le festival, après le film "Portrait d'une enfant déchue", le distributeur Carlotta invitait à une soirée sur la Terrazza Martini (plage du Gray d'Albion), mais Faye Dunaway, sans doute lassée par les reprises du film imputables au son défectueux lors de la projection (elle a fini par s'en aller) n'est pas là. Puis je me laisse convaincre d'aller faire un saut à la soirée Schwepses quotidienne (plage du Carlton), beaucoup plus animée, le tout engendre ensuite une demi-heure de marche à une heure du matin depuis le Carlton jusqu'au fin fond du vieux port, bien après le Radisson...
"We need to talk about Kevin" de Lynne Ramsay

 photo Diaphana / sortie 28 septembre 2011
photo Diaphana / sortie 28 septembre 2011
Pitch.
Une femme d'une quarantaine d'années, devenue paria de la société après une tragédie, se souvient des années qui ont précédé le drame, l'emprisonnement de son fils de 16 ans. Se rend compte qu'au fond, elle n'a jamais pu le supporter et cela depuis sa naissance.
Il y a souvent des films auquels on reproche leur absence de mise en scène, ici, c'est le contraire, le film souffre d'un excès de mise en scène : notamment, l'utilisation du rouge, de la première à la dernière image, même la peluche de la fillette est rouge. Eva, New-yorkaise énergique, désirait tellement un enfant, et on suppose que c'est depuis longtemps, quand elle est enceinte, c'est le bonheur absolu pour elle et son mari ; mais, très vite, Eva a du mal à supporter son fils qui hurle plus que l'usage ne le voudrait. Scène très forte où elle préfère le bruit du marteau-piqueur aux cris de Kevin.
De scènes cauchemardées en flash-backs, on remonte au drame, un drame "à la Gus Vant Sant", comme je l'ai entendu par ci par là, faisant référence à "Elefant". Mais la comparaison, de mon avis, s'arrête là. Pour marquer les époques, on a trois coiffures différentes pour Tilda Swinton, cheveux longs de la fiancée, cheveux noirs très courts de la mère, cheveux mi-longs chatains de la femme brisée. Le mari d'Eva, un homme bon, équilibré, s'occupe de Kevin, comme si de rien n'était, avec une constance touchante, qui, de son côté, multiplie les provocations adressées tacitement à sa mère. On le croit autiste, il est surdoué, hyperlucide, sans illusions. Les acteurs sont fabuleux de vérité, Tilda Swinton, parfaite, comme toujours, et John C. Reilly en contre-emploi d'une sensibilité discrète qu'on ne lui soupçonnait pas.
C'est un film très dur, les relations entre Kevin, qu'on montre entre environ 3 et 16 ans, avec ses parents sont terribles. L'arrivée d'une petite soeur est encore pire, Kevin la démolit, c'est à pleurer. On dirait que toute personne qui vient s'interposer entre sa mère et lui est insupportable pour l'enfant Kevin. Il semble bien d'ailleurs que l'origine du drame soit le projet du père, n'en pouvant plus, de se séparer de son épouse et de se présenter comme le tenant naturel de la garde des deux enfants, une conversation qu'entend Kevin adolescent depuis le haut de l'escalier. L'histoire est si forte que le parti pris ultra-démonstratif, effets, symboles, mise en scène ostentatoire, rouge sang, ne s'imposait pas...

,
We need to talk about Kevin,
Lynne Ramsay,
Portrait d'une enfant déchue,
Jerry Schatzberg
11 - 05
2011


Le Festival Cannes 64 a ouvert hier soir avec la présentation du dernier film de Woody Allen, "Midnight in Paris", dont on a surtout parlé à cause de la présence/absence de l'épouse du président de la république au générique, viendrait, viendrait pas monter les marches? Les échéances politiques de la prochaine campagne présidentielle prenant le dessus, elle n'est pas venue... Un Woody Allen en ouverture, c'est consensuel, ça a plu aux cinéphiles comme à l'assistance mondaine pas vraiment branchée ciné d'auteur, en nombre pour ouvrir le festival. Personnellement, je n'avais aucune envie de voir ce film et je ne l'ai pas vu (il est sorti aujourd'hui en salles)... Au lieu de ça, j'ai pris la température de la ville, inchangée avec ses barrières autour du palais des festivals, ses ballets de limousines pour amener les invités sur le red carpet, ses gardes du corps musclés devant l'entrée du Majestic. Et quelques photos de la star de la soirée, Mélanie Laurent, maîtresse de cérémonie pour l'ouverture de ce 64° festival de Cannes, très belle en version platinée, habillée de noir... La presse a vu hier soir le premier film en compétition "Sleeping beauty", premier long-métrage australien de Julia Leigh, qui sera présenté officiellement aujourd'hui, je vais donc essayer de le voir dès que possible...

 Mélanie Laurent
Mélanie Laurent

 Johnnie To
Johnnie To
Mots-clés : Cannes 2011